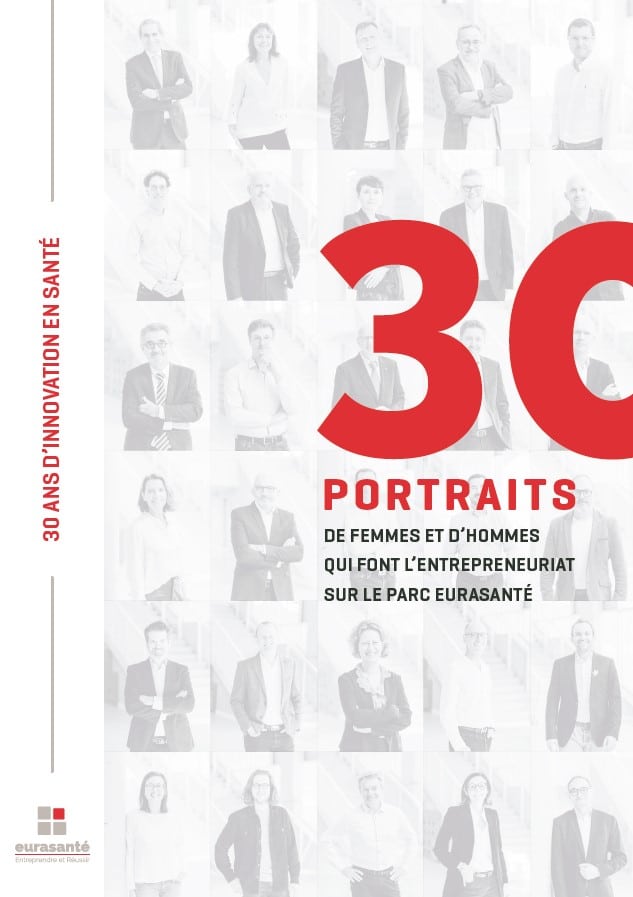PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS, PRATICIEN HOSPITALIER AU CHU DE LILLE, DIRECTEUR DE L’UMR1167 RID-AGE, DIRECTEUR DU LABEX DISTALZ, ANCIEN DIRECTEUR DE L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE, COFONDATEUR DE GENOSCREEN

« Il y a donc un temps long de la recherche, et il est indispensable de financer cette acquisition de connaissances. Mais il est aussi important selon moi – peut-être parce que je suis médecin de formation -d’améliorer la vie des patients et des aidants maintenant, pas dans 10 ans. »
En tant que médecin et chercheur reconnu mondialement, quel est selon vous le rôle de l’entrepreneuriat dans l’accélération de l’innovation ?
J’ai identifié près de 80 gènes liés à la maladie d’Alzheimer, mais il faudra encore 5 à 10 ans pour analyser le rôle de chacun d’eux. Ce travail s’étendra sur plus de 30 ans, et les résultats profiteront surtout aux générations futures plus qu’aux malades actuels.
Il y a donc un temps long de la recherche, et il est indispensable de financer cette acquisition de connaissances. Mais il est aussi important selon moi – peut-être parce que je suis médecin de formation – d’améliorer la vie des patients et des aidants maintenant, pas dans 10 ans. Et, la meilleure solution est d’allier une équipe de recherche et une start-up. Il ne faut pas opposer public et privé. Il y a une complémentarité évidente avec des avantages et des inconvénients pour les deux parties.
Le secteur public seul est incapable de monter un essai clinique car l’investissement est trop important. Le privé, lui, est un vecteur majeur pour accélérer le développement des innovations. Or, à l’échelle mondiale, il faut aller vite car la compétition est féroce, et les idées utiles germent simultanément dans les cerveaux de plusieurs équipes.
Or, c’est la raison d’être d’une entreprise que d’apporter des solutions à une problématique utile à la population, comme par exemple développer et commercialiser un nouveau traitement. Il est donc crucial d’encourager très tôt les interactions entre les chercheurs et les entreprises. Dans le champ du médicament et des traitements en général, l’engagement du privé est essentiel pour aboutir rapidement
Avec votre expérience internationale, comment percevez-vous les différences culturelles et structurelles dans l’entrepreneuriat scientifique entre l’Europe et l’Amérique du Nord ?
L’entrepreneuriat implique une prise de risque, et il faut être accompagné par des personnes qui vous font confiance et partagent ce risque avec vous, issues du monde scientifique, managérial et financier. En Amérique du Nord et au Canada en particulier, il y a beaucoup de créations mais aussi beaucoup de disparitions d’entreprises. Cela assure un « bouillon de culture » innovationnel garantissant un flux et une circulation permanente des projets. L’équipe d’une start-up qui s’arrête sera immédiatement reprise par une autre qui se crée, ce qui permet aux compétences de ne pas se perdre et aux innovations de prospérer. En Amérique du Nord de manière générale, cet état d’esprit permet de transformer l’échec d’une entreprise en une expérience structurante. En France, cet échec est plus difficile à gérer.
Il est aussi souvent plus aisé dans ces pays, pour les chercheurs, de lever des fonds privés afin de financer des start-ups ou des projets de recherche appliquée. Le capitalrisque est bien développé et ouvert à l’investissement dans des projets issus de la recherche académique. Au Canada, l’amorçage d’un projet pourra atteindre 1 M€, alors qu’en France, on sera plutôt entre 50K€ et 100 K€.
Au niveau de la recherche, les possibilités de collaboration d’un chercheur académique avec une entreprise privée ont longtemps été compliquées. Aujourd’hui, les lois Allègre et PACTE 1 et 2 (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) ont significativement amélioré les conditions de travail des chercheurs et encouragé le transfert de technologie. Mais beaucoup de chemin reste à faire, notamment en matière d’état d’esprit entrepreneurial.
Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever pour mieux traiter les maladies chroniques à l’avenir ?
Il faut effectivement d’abord comprendre les maladies chroniques pour pouvoir mieux les prendre en charge. Les développements de la recherche fondamentale et clinique laissent entrevoir de nouvelles perspectives de prévention et de traitement, ouvrant la voie à une médecine personnalisée et à un allongement de l’espérance de vie sans invalidité.
En 2011, nous avions déjà porté la première candidature aux IHU[1] avec Eurasanté sur un projet dédié à la médecine personnalisée, dont nous avions déjà anticipé l’explosion. Malheureusement le projet n’a pas été retenu.
Mais, à titre personnel, l’objectif demeure de développer une prévention la mieux ciblée possible. Elle permettra de réduire significativement la prévalence des maladies chroniques – de plus de 40% pour une affection comme la maladie d’Alzheimer. Je ne parle pas de guérison de la maladie mais d’un développement des premiers symptômes beaucoup plus tardif voir postérieur au décès du patient. Nous pourrions ainsi aller vers une augmentation significative de l’espérance de vie sans incapacité, qui permettrait de résoudre de nombreux problèmes, y compris économiques, de nos populations vieillissantes. Une telle approche ne pourra se construire qu’avec le soutien à long terme d’une volonté politique forte.
[1] IHU : Institut Hospitalo-Universitaire