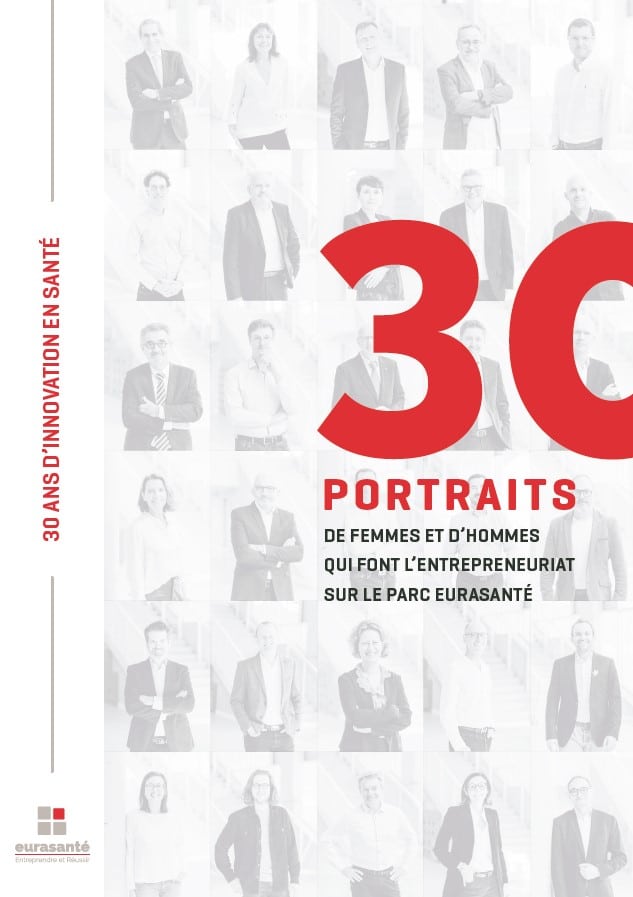COORDONNATEUR DU CIC-IT 1403, CHU DE LILLE

« Un projet n’est jamais vraiment terminé : créer une start-up n’est pas la seule solution, il y a toujours d’autres moyens de faire de la valorisation. »
Comment votre parcours au CHU de Lille vous a-t-il conduit à reprendre vos études et à créer des startups pour valoriser vos travaux ?
J’ai un parcours plutôt atypique. Je suis arrivé au CHU de Lille en 1999, à l’Institut de Technologies Médical, en tant que technicien supérieur hospitalier avec un Bac+2. C’est sous l’impulsion du Professeur Régis Logier, alors Directeur du laboratoire, que j’ai décidé de reprendre mes études tout en continuant à travailler.
J’ai ainsi obtenu une licence, une maîtrise, un DEA (équivalent actuel du master), puis j’ai soutenu une thèse en sciences et une habilitation à diriger les recherches. Depuis septembre 2023, je coordonne le Centre d’Investigation Clinique – Innovation Technologique au CHU de Lille en binôme avec le Professeur Sylvia Pelayo.
Dans ce cadre, j’ai tout de suite été plongé dans l’entrepreneuriat : le Professeur Régis Logier était déterminé à valoriser nos travaux. Il approchait les grands groupes pour licencier des brevets, mais nous avons vite constaté que ces entreprises montraient peu d’intérêt pour les innovations de rupture. C’est ainsi que nous avons décidé de créer nos propres start-ups, avec l’ambition de développer nos idées depuis le laboratoire jusqu’au lit du patient en les mettant nous-mêmes sur le marché. Très rapidement, j’ai commencé à travailler avec Eurasanté.
Notre première start-up, Estaris Monitoring, a été lancée en 2001. Elle avait pour objectif de concevoir des dispositifs sur mesure pour le traitement des signaux physiologiques, destinés aux chercheurs. Nous avons réussi à lever des fonds, mais malheureusement, nous n’avons pas trouvé le marché adéquat, et en 2006, nous avons dû arrêter.
Nous étions jeunes chercheurs et ingénieurs, mais encore novices en tant qu’entrepreneurs. Même si nous avons dû stopper, je ne considère pas cela comme un échec, mais plutôt comme une expérience enrichissante. Nous avons beaucoup appris de nos erreurs
Votre laboratoire et vos travaux ont contribué à donner naissance à de nombreuses start-ups, pouvez-vous nous en dire plus ?
Effectivement, quelques années plus tard, nous avons décidé d’incuber un nouveau projet qui est devenu Mdoloris Medical Systems. À l’origine, nous étions quatre salariés du CHU de Lille à travailler sur ce projet. Nous avons pris notre temps pour trouver le bon porteur de projet, et c’est Fabien Pagniez qui s’est révélé être la personne idéale.
Aujourd’hui, la start-up est présente dans plus de 70 pays, avec de nombreuses publications et un chiffre d’affaires significatif. Nous avons aussi établi des partenariats solides et déposé plusieurs brevets.
J’ai aussi travaillé sur d’autres start-ups comme Fysali, une spin-off du laboratoire qui se concentre sur la prévention de l’énurésie nocturne ou Fipsico, qui malheureusement a déposé le bilan cette année. C’était un projet sur la somnolence au volant, mais le principal investisseur s’est retiré. Enfin, D’autres start-ups sont également issues du savoir-faire du laboratoire. Comme ReverTech, incubée en 2021, qui travaille sur une prothèse intestinale et prévoit une étude clinique chez l’humain en 2026. Il y a également la société Useconcept qui fait de l’évaluation ergonomique et qui est issue du savoirfaire d’autres membres de l’équipe.
Au CHU de Lille, la valorisation ne se limite pas à des publications. Le CHU de Lille et sa direction à la recherche et à l’innovation ont selon moi été précurseurs dans la valorisation de la recherche. Eurasanté a été un atout indéniable depuis plusieurs années dans ce parcours, tout comme la SATT Nord qui nous a apporté son appui dans plusieurs opérations de transferts de technologie.
Selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour réussir à la fois en tant que chercheur et entrepreneur dans le domaine de la Medtech ?
Parfois, ce sont des chercheurs qui portent la start-up, mais pour Mdoloris par exemple, aucun d’entre nous n’avait la fibre entrepreneuriale. C’est pour cela que nous avons choisi de nous impliquer en tant qu’actionnaires ou au sein du comité scientifique,mais sans aller plus loin dans la gestion quotidienne.
Il n’y a pas un seul schéma possible. Être CEO d’une startup, je ne l’ai jamais été et je suis admiratif, car cela demande un énorme investissement personnel. Pour réussir dans ce domaine, il faut avoir la fibre entrepreneuriale. On ne peut pas être chercheur à mi-temps et entrepreneur à mi-temps. Tenter l’expérience, que ce soit une réussite ou un échec, est toujours formateur, tant pour l’individu que pour le projet.
L’échec, comme le dépôt de bilan, n’est jamais facile, mais on apprend à relativiser. Un projet n’est jamais vraiment terminé : créer une start-up n’est pas la seule solution, il y a toujours d’autres moyens de faire de la valorisation.
Le domaine de la Medtech s’est complexifié mais aussi harmonisé au niveau européen. C’est un secteur qui a souffert avec les crises récentes, mais nous sommes très impliqués au niveau national et européen, notamment à travers des réseaux comme TECH4HEALTH. J’ai aussi rejoint récemment la cellule partenariat industriel du CHU de Lille et le Comité Scientifique et Éthique d’Eurasanté pour favoriser le transfert technologique.