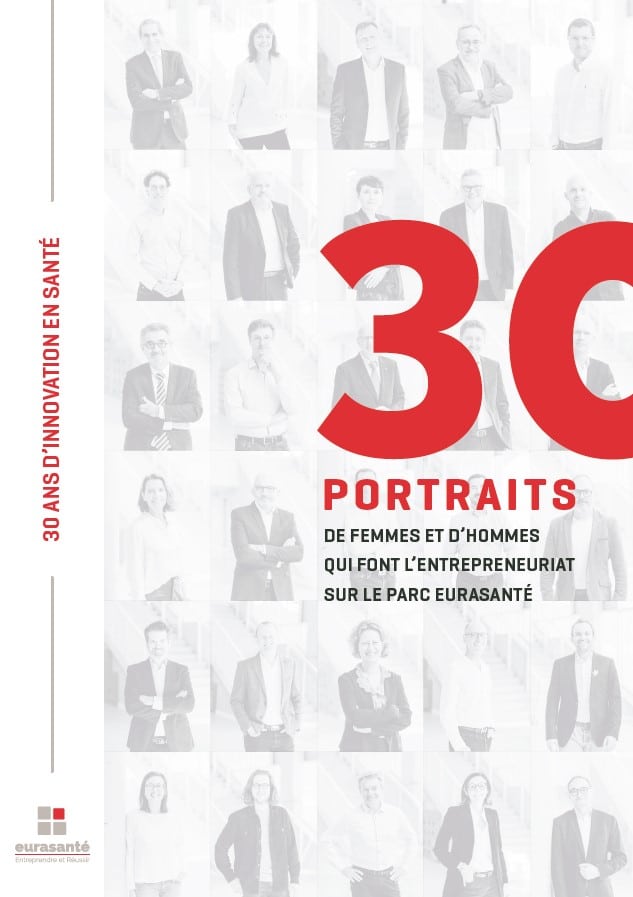DIRECTEUR GÉNÉRAL, CENTRE OSCAR LAMBRET

« Parfois les start-ups sont amenées à devoir faire des choix avant tout guidés par l’économique, mais pour nous médecins, c’est différent. Aussi, quand on rencontre un porteur et un projet avec qui l’on est aligné sur la vision, que ça coïncide, il faut y aller. On est tout à fait capable de porter ensemble quelque chose qui a du sens, où chacun peut trouver sa place et qui bénéficie à tous. »
Vous êtes aujourd’hui le Directeur Général du Centre Oscar Lambret (COL), centre de lutte contre le cancer des Hauts-de-France. Pouvez-vous me parler de votre parcours ?
Je suis médecin de formation, avec une spécialisation en cancérologie. Après avoir démarré mes études de médecine en Côte d’Ivoire, je les termine en France, à Paris.
J’arrive à Lille il y a 25 ans, en 1999. Je rejoins la Faculté de médecine de Lille, où il n’existe pas encore de Chaire en oncologie-radiothérapie et serai donc le premier à développer la valence universitaire de cette discipline au sein de la Faculté.
Après 15 ans comme chef de service en radiothérapie, je prends ensuite la direction générale du Centre Oscar Lambret (COL) en 2016, les centres de lutte contre le cancer ayant la particularité, depuis leur création en France en 1945, d’être dirigés par des médecins. Aujourd’hui je suis bien sûr toujours un médecin mais beaucoup moins un soignant. Mon quotidien est la coordination, la stratégie, les décisions économiques et médicales,…
Le COL s’inscrit dans une Histoire, liée d’ailleurs à celle du développement du Campus hospitalo-universitaire. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Dans les années 1930, le Dr Oscar Lambret, chirurgien, créé le « Centre anti-cancéreux », une dizaine d’années après la création à Paris de l’«Institut du Radium », renommé depuis « Institut Curie ». Durant ces années, les centres de ce type fleurissent partout en France et en Europe.
Dans les années 1930 et 1940, le cancer devient un enjeu de santé publique. Une ordonnance du Général de Gaulle en octobre 1945 confère d’ailleurs aux hôpitaux dédiés à la lutte contre le cancer un statut particulier avec la volonté de prendre en charge tous les patients ; un souhait rendu possible par la création de l’Assurance Maladie dans les jours suivants. Aujourd’hui, près d’un siècle après la création de ces centres, ce statut et cet objectif n’ont pas changé.
Le Centre Oscar Lambret a été au coeur de la Cité hospitalière de Lille, débutée avec l’Hôpital Calmette en 1936, finalisée en 1939 et ouverte avec l’hôpital Huriez et le Centre au début des années 50. Ce campus hospitalo-universitaire s’est progressivement développé avec d’autres hôpitaux, facultés et écoles. J’ai été le témoin durant les 25 dernières années de sa croissance qui n’est toujours pas finie, preuve en est la création du Hub Eurasanté. Aujourd’hui, quand je présente le campus à des gens extérieurs, ils sont bluffés par sa cohérence !
Les liens entre le COL et Eurasanté sont anciens et sources de collaborations réussies. Avez-vous des exemples à nous partager ?
En effet, notre histoire commune remonte au démarrage d’Eurasanté. Je pense particulièrement à 2 exemples de collaborations réussies qui m’ont marqué.
La première, c’est l’obtention du 1er SIRIC (Site de Recherche Intégrée contre le Cancer) à Lille il y a 10 ans. Sans l’accompagnement d’Eurasanté pour structurer la candidature et y faire ses apports méthodologiques, nous n’aurions pas réussi. Il en est de même pour la création du bâtiment ONCOLille du même nom, qui a suivi quelques années après, grâce à l’obtention d’une aide dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région. En tant que membre fondateur du GIS ONCOLIlle, ce projet a permis de pleinement faire comprendre à nos médecins et chercheurs la valeur d’Eurasanté, car le GIE était jusqu’alors perçu par ces profils comme un simple accompagnateur de start-ups. Ici, Eurasanté a révélé son rôle décisif pour accompagner la structuration d’un écosystème de recherche et le dynamiser.
Le deuxième exemple de collaboration qui me vient en tête est celui de l’organisation par Eurasanté en lien avec NFI de deux missions d’étude au Japon. Ces déplacements nous ont permis de rencontrer des entreprises japonaises afin de leur présenter le campus et nos forces thématiques. C’était à la fois riche et créateur d’emplois – preuve en est l’implantation de la société Horiba sur le Parc Eurasanté en 2021.
L’intermédiation d’Eurasanté vous a également permis de vous connecter à l’écosystème des start-ups, jusqu’à aujourd’hui investir au sein de celles-ci. Pouvez-vous nous en parler ?
En effet, nous avions déjà interagi avec des entreprises du Parc, notamment avec Bayer avec qui nous avions développé des projets dans le champ des sarcomes.
Plus récemment, nous avons noué des collaborations avec la start-up Céléos issue d’une success story scientifique sur le sujet des lipidomiques et protéomiques tumorales. Cela a été une belle rencontre professionnelle, et une opportunité à saisir pour nous lancer dans la prise de participation au sein d’une start-up. Parfois les start-ups sont amenées à devoir faire des choix avant tout guidés par l’économique, mais pour nous médecins, c’est différent. C’est pour cela que nous n’avions pas encore franchi le cap, alors même que cela est déjà assez coutumier pour un certain nombre de centres de lutte contre le cancer français. Aussi, quand on rencontre un porteur et un projet avec qui l’on est aligné sur la vision, que ça coïncide, il faut y aller. On est tout à fait capable de porter ensemble quelque chose qui a du sens, où chacun peut trouver sa place et qui bénéficie à tous.
Le mot de la fin ?
Je tiens d’abord à remercier Eurasanté, qui est un outil assez extraordinaire à disposition des acteurs régionaux. Eurasanté a réussi à devenir un partenaire naturel pour nous, nos médecins, nos chercheurs. On sent une vraie proximité entre nos structures, une écoute attentive, un lien très humain et une volonté renouvelée de nous accompagner dans la résolution de nos problématiques. Eurasanté a eu un développement considérable et je salue l’intelligence avec laquelle il s’est réalisé, sans perdre en route les acteurs qu’il accompagne.
J’ai ensuite évidemment une pensée pour le chemin parcouru par le COL : d’un hôpital centré sur le soin, nous sommes devenus un centre de référence sur les enjeux de recherche en cancérologie, travaillant quotidiennement, notamment grâce au SIRIC, avec les équipes du CHU de Lille, de l’Université de Lille, de l’INSERM et du CNRS. C’est un très beau collectif régional ainsi formé pour toujours mieux oeuvrer au service de la recherche et de l’innovation en faveur des patients atteints de cancer.