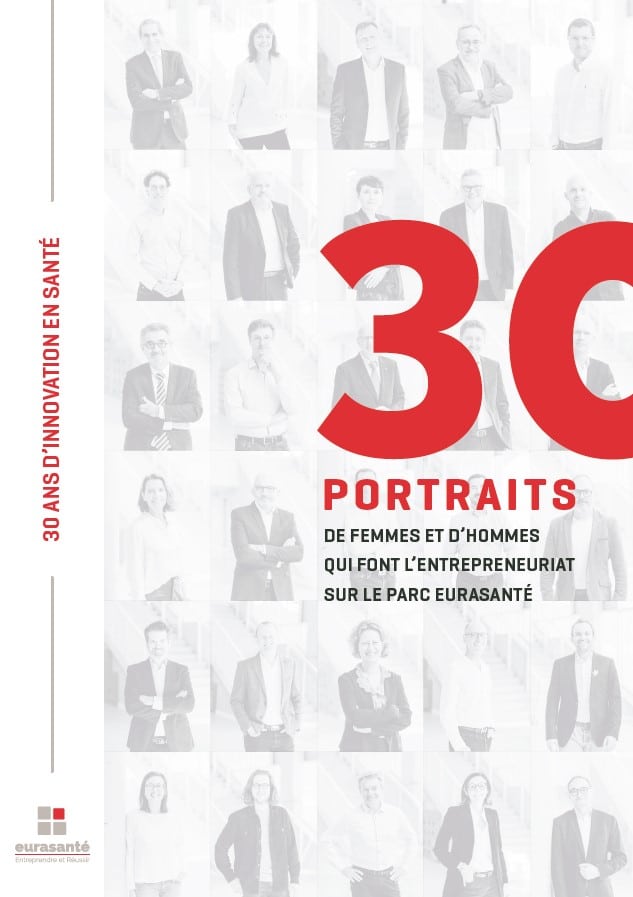DIRECTEUR DE L’UNITÉ INSERM UMR 1011, COFONDATEUR DE GENFIT, PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

« Le lien entre l’ensemble de mes recherches, c’est surtout ma volonté constante de répondre à des problématiques qui ont un impact direct sur la qualité de vie des patients »
Le choix de vous engager dans des études scientifiques s’est-il imposé naturellement à vous ?
Le choix de m’engager dans des études scientifiques ne s’est pas imposé naturellement au départ. Ce n’était ni un rêve d’enfant, ni une ambition claire. Mes parents n’étaient pas issus du domaine scientifique, ce qui m’a même amené à explorer des voies comme l’économie et le droit, ce qui montre bien que ce n’était pas une évidence ! Cependant, j’ai toujours eu un intérêt prononcé pour les sciences, particulièrement pour la chimie et les mathématiques, deux disciplines qui me passionnaient à l’époque. C’est en partie grâce à mon entourage familial, notamment grâce à l’influence de mes neveux en pharmacie, que j’ai été amené à suivre cette voie.
Après cinq années d’études en pharmacie, malgré une solide formation en chimie, je n’envisageais pas une carrière de pharmacien. Ce qui me passionnait vraiment, c’était de comprendre le mode d’action des médicaments. J’ai donc poursuivi mes études avec une thèse en endocrinologie, en 1986, au moment où la révolution moléculaire apportait des perspectives inédites et captivantes.
Pendant mon doctorat, j’ai fait un pari risqué en m’aventurant dans un domaine que je ne connaissais pas très bien, celui du cholestérol.
Ce chemin m’a finalement mené à Lille en 1993, où j’ai travaillé sur le métabolisme du cholestérol dans le laboratoire du Pr. Fruchart à l’Institut Pasteur de Lille.
Finalement, lorsque l’European Atherosclerosis Society m’a décerné en 2024 le Prix «Anitschkow» pour l’ensemble de ma carrière, je pense pouvoir en conclure que cette orientation de carrière s’est révélée être un pari réussi !
Vous avez été pionnier dans l’étude des récepteurs nucléaires1 et vous avez également exploré les maladies métaboliques et cardiovasculaires. Quel fil conducteur relie l’ensemble de vos travaux de recherche ?
Je me suis toujours investi pour répondre aux défis cliniques majeurs, notamment dans les domaines des maladies cardiovasculaires, de l’obésité et du diabète. Au fil des années, j’ai transformé l’unité de l’INSERM que je dirige, en y intégrant de nouvelles technologies et en attirant des chercheurs de haut niveau. Aujourd’hui, nous avons sept équipes qui explorent différentes facettes du métabolisme, chacune apportant son expertise spécifique.
Mon objectif a toujours été de poursuivre la recherche académique tout en restant à la pointe de l’innovation. Dès 2008, avec le lancement du Programme Investissements d’Avenir (PIA), j’ai continuellement cherché à identifier les prochaines étapes et à intégrer de nouvelles technologies dans nos travaux. En tant qu’unité de recherche, nous avons l’avantage d’être une structure plus petite et plus spécialisée qu’un centre de recherche, c’est ce qui nous permet de mettre un fort accent sur la recherche intégrée.
En 1986, mes recherches étaient centrées sur les statines et les fibrates, deux classes de médicaments utilisés principalement pour abaisser le taux de cholestérol et de lipides dans le sang, des traitements utilisés chez l’Homme, mais dont le mécanisme d’action restait alors encore largement méconnu. Au fil du temps, l’évolution de mes travaux a été guidée par l’intérêt clinique croissant pour ces questions. Le lien entre l’ensemble de mes recherches, c’est surtout ma volonté constante de répondre à des problématiques qui ont un impact direct sur la qualité de vie des patients. Avec le vieillissement croissant de la population et l’augmentation des cas de maladies chroniques par exemple, je m’efforce d’explorer des pistes de recherche susceptibles d’améliorer la prise en charge de ces patients vulnérables, en mettant l’accent sur des solutions innovantes et adaptées à leurs besoins spécifiques.
J’ai toujours eu à coeur d’adopter une approche transversale, en collaborant avec des chercheurs de haut niveau et en travaillant sur plusieurs fronts simultanément. De plus, j’ai essayé d’introduire dans mon laboratoire une dimension plus industrielle, pour que nos recherches soient à la fois académiques et applicables au monde réel.
En 1999, vous avez cofondé Genfit, la première entreprise à s’implanter sur le Parc Eurasanté, aujourd’hui cotée au Nasdaq. Vous en êtes également Président du conseil scientifique. Qu’est-ce qui vous motive au quotidien dans cette aventure entrepreneuriale ?
En effet, Genfit a fêté ses 25 ans en 2024, et cette aventure a été motivée dès le départ par l’idée de collaborer avec différents acteurs industriels pour développer des programmes innovants. Aux côtés du Pr. Jean-Charles Fruchart, Jean-François Mouney et Florence Séjourné, nous avons lancé cette initiative avec l’objectif initial de créer un laboratoire mutualisé. Il s’agissait de trouver un équilibre entre les collaborations avec les industriels, les scientifiques et le monde des affaires.
Au fil du temps, nous avons réussi à adapter notre modèle, notamment lors de notre entrée en bourse au Nasdaq qui nous a ouvert l’accès à des financements américains. Cette décision nous a conduit à évoluer vers une véritable entreprise pharmaceutique.
L’un des grands jalons de cette aventure a été le développement de l’elafibranor qui a obtenu l’approbation de la FDA (Food and Drug Administration) et est désormais commercialisé aux Etats-Unis. Genfit est d’ailleurs la première biotech française à avoir réussi à développer une molécule destinée au marché américain, ce dont je suis particulièrement fier.
Je suis très heureux également d’avoir établi un lien fort entre le monde académique et l’innovation pharmaceutique, en particulier sur des enjeux cruciaux comme le vieillissement et la longévité. Voir nos travaux avoir un impact réel sur la santé des patients est ce qui me pousse à continuer dans cette aventure entrepreneuriale et innovante.